
Mais pourquoi avoir titré mon dernier point marché … « Malgré l’exceptionnalisme Américain... L’Europe Boursière n’a pas dit son dernier mot ! »
En quelques jours, le monde a profondément changé. On pensera ce que l’on voudra de Donald Trump, mais on ne pourra pas lui dénier le mérite d’imposer le grand retour de la volonté en politique et ne pas en voir d’impact. Cet activisme hors norme s’exerce par la recherche d’accords – de deals – obtenus par une violence à laquelle nos démocraties occidentales ne sont pas habituées. En institutionnalisant l’incertitude et l’instabilité, Donald Trump force le « reste du monde » à se concentrer sur ses propres forces et sa souveraineté dans le but affiché d’alléger le « fardeau » de l’Oncle Sam.
Souvenons-nous du 28 février dernier, le jour de l’humiliation télévisée du président ukrainien, Zelensky, par Trump et l’interprétation que les Européens en ont immédiatement tirée, à savoir que les États-Unis ne sont plus leurs alliés.
Deux jours après, une douzaine de dirigeants européens se réunissaient pour tenter d’exister face aux États-Unis alors que l’Allemagne s’apprêtait à annoncer un programme d’investissement dans la défense et les infrastructures à hauteur de 20% de son PIB.
L’Europe et l’Allemagne ont renoncé en deux jours à l’orthodoxie budgétaire qui était l’un de leurs marqueurs économiques les plus forts.
La « menace russe » justifie tout. Elle permet surtout d’entrevoir au bout du tunnel la lumière d’une croissance plus forte à laquelle le pouvoir politique européen avait depuis longtemps renoncé, dans sa soumission aux critères de Maastricht et par peur panique de l’inflation.
En fournissant à l’Europe un alibi pour lui permettre de participer activement à la croissance de l’économie mondiale et en imposant au Vieux Continent de contribuer largement à l’effort de défense comme il l’en avait maintes fois menacé lors de sa campagne présidentielle, Trump « Makes Europe Great Again ».
Mais que dirait Benjamin Franklin de la politique de Donald Trump ?
Benjamin Franklin fut le premier ambassadeur des Etats-Unis en France, il était passionné de météorologie, premier cartographe du Gulf Stream, inventeur du paratonnerre.
Nous pouvons penser à lui tous les ans, au moment du changement d’heure car il fut sans doute le premier à proposer de modifier les horaires de sommeil pour faire des économies. En effet, le week-end du 30 mars, à l’occasion du passage à l’heure d’été, j’ai lu que Benjamin Franklin fut le premier ambassadeur des États-Unis en France et qu’il avait proposé aux parisiens de se lever plus tôt pour mieux profiter du soleil et le soir économiser les bougies.
Personnalité politique de premier plan, Membre de la commission des 5, il était chargé de plancher sur le projet de déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique rédigé en 1776. Benjamin Franklin né en 1706 et mort en 1790 ne craignait pas les mots de la science. L'électricité le fascinait. On lui doit le terme de batterie, de condenseur, de charge. Il affirma la nécessité de relier l'électricité à la terre.
Que dirait il aujourd'hui, lui ce passionné des phénomènes climatiques, s'il entendait le flot de paroles de Donald Trump exigeant qu'on interdise sur les sites ou documents officiels de l'état toute publication concernant le changement climatique et toute référence au travail des scientifiques sur le sujet.
Que penserait Benjamin Franklin de cette scène hallucinante, ou l'actuel chef de l'État américain, Donald TRUMP ricane en annonçant qu'il vient de signer un décret pour éliminer le ministère fédéral de l'éducation ?
Nous pouvons imaginer qu’il inviterait Donald Trump à relire le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui interdit à l'Etat de porter atteinte à la liberté d'expression, de religion et celle de la presse.
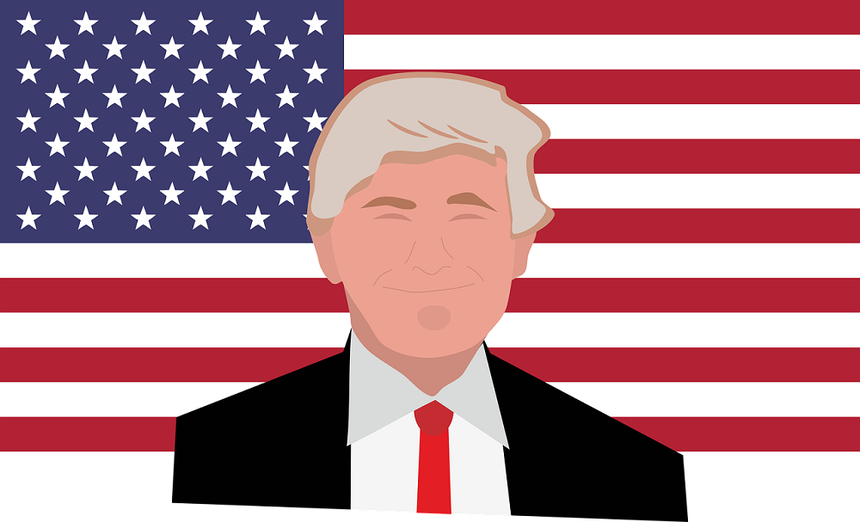
Mais pourquoi le Trumpiste est voué à l’échec ?
Le retour aux affaires de Donald Trump a poussé les investisseurs à se positionner sur des stratégies relativement simples, en lien avec les orientations politiques du nouveau président. Mais la plupart de ces stratégies ont échoué, parce que la réalité et la fiction ont rapidement divergé. Le dollar fort ? Le billet vert a perdu près de 6% depuis le 1er janvier, soit l'une de ses pires performances trimestrielles depuis la crise de 2008.
L'avènement du bitcoin ? La cryptomonnaie est la classe d'actifs la moins prolifique de ce début d'année, avec une chute de 26%.
Tous les "Trump Trade" n'avaient pas échoué, jusqu’au jours de la « libération » - ce fameux 2 avril 2025, avec les droits de douane – mais c’est une bonne leçon pour tout le monde : en investissement, l'écart entre une idée simple et une idée simpliste est souvent ténu.
Pourquoi délocaliser ce qu'on peut produire chez soi ?
C'était une idée de la fin du 20e siècle et qui a perduré jusqu'au début du 21e : délocalisons l'activité industrielle à faible marge de profit dans des pays où la main d'œuvre est si peu chère que l'on pourra tout de même tirer notre épingle du jeu et gardons chez nous l'activité économique à forte valeur ajoutée, comme les technos ou l'aérospatiale par exemple.
Cela a très bien fonctionné pendant un temps en faisant croître les géants industriels que sont aujourd'hui la Chine et l'Inde et en donnant naissance à des incongruités comme des jeans Levi’s, icône américaine ultime, fabriqués au Lesotho dans le sud de l'Afrique.
Puis est survenue la pandémie de COVID-19 qui a fait tomber le château de carte de cette économie mondialisée. Les restrictions sanitaires, différentes d'un pays à l'autre, on fait dérailler des chaînes d'approvisionnement. Les pays qui ne produisaient pas leur propre vaccin étaient prêts à en acheter à prix d'or à qui pouvait leur en fournir pour sauver leur population.
D'où la question toute simple qui s'est imposée partout en Occident : pourquoi délocaliser ce qu'on peut très bien produire chez soi ? L'idée de souverain et économique revenait en force.
Nous assistons en effet à l'essoufflement de l'offshoring, à savoir la délocalisation à l'international, pour un reshoring, à savoir ramener la production chez soi, ou même un nearshoring, à savoir délocaliser la production dans un pays plus proche géographiquement. C’est une accélération depuis le réveil brutal de la pandémie, les tensions géopolitiques comme les conflits armés entre Ukraine et au Moyen-Orient.
Ce phénomène est encore plus vrai aux États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Depuis 2021 il y a beaucoup plus de multinationales américaines entre autres, qui disent mettre en place des plans de reshoring ou nearshoring dans leur plan stratégique à moyen terme. D'autres pays occidentaux comme la France, L'Allemagne ou encore l'Espagne ont également entamé cette réflexion dont les effets n'ont cependant aucune mesure avec ce qui se prépare dans la foulée de l'élan protectionniste des États-Unis.
La lutte au changement climatique a aussi eu pour effet de donner du souffle au mouvement de réindustrialisation dans plusieurs pays d'Europe et régions des États-Unis où, afin de réduire la pollution, de nombreuses centrales électriques alimentées au charbon ont été fermées.
En effet il fallait redynamiser ces secteurs ou des emplois industriels fort bien payés faisaient vivre des communautés entières. C'est de là, qu'est née, l'idée de faire revenir de la production manufacturière chez soi ou à tout le moins près de soi.
Les États-Unis, par exemple, utilise de plus en plus le Mexique pour la production à plus bas prix parce qu'il y a un gros levier sur les frais d'expédition. En effet, les coûts de transport d'un conteneur sont 4 fois moindres lorsque ce conteneur provient du Mexique plutôt que de la Chine, et ce, quand bien même Trump décide officiellement d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur les biens produits au Mexique et au Canada.
Mais 25% de tarifs contre 4 fois moins cher de transport ça demeure jouable pour un importateur américain.
Il est vrai aussi que les salaires sont plus élevés en Occident que dans la plupart des pays en développement ou la production industrielle a été délocalisée au fil des ans. Mais plus important encore, la plupart des pays occidentaux vivent un phénomène de pénurie, ou à tout le moins de rareté de main-d'œuvre en raison du vieillissement de la population.
C'est bien beau de vouloir produire dans son pays mais encore faut-il avoir les bras pour le faire !
Il faudra donc robotiser : en effet les bras devront être mécaniques plutôt qu’humains et la robotisation et l'automatisation des tâches industrielles devront se déployer à vitesse grand V encore jamais vue.
Ce sera encore plus vrai aux États-Unis si le président Trump donne suite à ses intentions de déporter massivement des millions de personnes immigrantes en situation irrégulière.
Ces personnes qui occupent souvent des emplois dont les Américains « de souche » ne veulent pas.
En effet, la plupart de ces gens-là travaillent et les États-Unis vont avoir des problèmes encore plus sérieux pour trouver du monde et la seule solution ce serait la robotisation et l'automatisation.
Mais n'oublions pas que la réindustrialisation d'une nation requiert également des ressources énergétiques. Même le Québec, qui nageait il n'y a encore pas si longtemps dans les surplus d'électricité, peine à trouver des blocs d'énergie que ses industriels, établis ou de retour d'exil réclament.
Un autre paramètre non négligeable et qu'il faut tenir compte également de l'espace nécessaire à l'implantation de centaines de nouvelles usines ce qui n'est peut-être pas un problème au Canada mais qui peut l'être dans d'autres pays qui ont une densité importante.
Enfin il va falloir aussi accepter que la pollution industrielle se fasse sur nos territoires plutôt que dans les pays en voie de développement.
La puissance Economique est indispensable :
Donald Trump est dans le business, il ne parle que business et il a su parler aux classes moyennes américaines, à qui, il cherche à redonner de la fierté et des perspectives.
Les classes moyennes sont en réalité la classe majoritaire et après des décennies de chômage, la désindustrialisation, la montée des charges et des impôts, la hausse de l’inflation a été un coup très dur pour la classe moyenne. Donald Trump l’a bien compris.
Pour autant il n'y a pas que le business, en effet, n’oublions pas que la puissance économique est indispensable. Sans elle on aura des moyens de rien : ni de maintenir notre modèle social ni de progresser en termes de pouvoir d'achat ni de défendre nos valeurs mais pour autant elle n'est pas une fin en soi.
Le produit intérieur brut (PIB) et le revenu moyen des Américains ont augmenté deux fois plus vite que ceux des européens ces dernières années ce qui n'empêche pas des États-Unis d'être confronté à une crise morale profonde. « Make America Great Again » ne peut pas être un projet de société. Le couple Donald Trump / Elon Musk va se heurter à la réalité d'un monde beaucoup plus complexe qu'il ne l'imagine et qui ne va pas se coucher devant eux comme cela.
Un des points marchés de 2024 (octobre) était titré : « l’innovation va nous sauver »
Il nous faut un sursaut à l'échelle de l'Europe afin d'éviter la tiers-mondisation de notre vieux continent. En effet Donald Trump n'aurait jamais adopté une telle attitude vis-à-vis de l'Europe si celle-ci n'avait pas décroché au début des années 2000, en ratant la première révolution technologique.
Celle de l'intelligence artificielle arrive à toute vitesse et elle pourrait conduire à ce que soient automatisés jusqu'à 1/3 des emplois à l'horizon 2030.
Après l'effondrement des emplois industriels c'est l'effondrement des emplois de services (l'autre point d'ancrage des classes moyennes) qui se profile.
La formation professionnelle de tous à l'IA, l'adaptation au monde qui vient sont des urgences absolues. Depuis la crise de 2008, la production Européenne a quasiment stagné alors que la production américaine a augmenté de 75%. Cela étant, l'Europe peut encore agir et le rapport Draghi, qui préconise un effort massif dans l'innovation supérieur à celui du plan Marshall de l'après-guerre, montre la voie.
Que faire aujourd’hui ?
Les annonces tarifaires de Donald Trump étaient attendues mais leur ampleur a surpris tous les observateurs. Le 2 avril devait apporter de la visibilité, il a finalement accentué l’incertitude et augmenté le risque de récession aux Etats-Unis. Ces hausses de tarifs sont les plus importantes depuis les années 1900. Elles créent de l’inflation, une érosion du pouvoir d’achat du consommateur américain et des problématiques de « rétorsions » potentielles des autres pays. Que ce soit sur le plan économique ou militaire, l’ordre mondial des 50 dernières années est détricoté et la visibilité s’est brutalement réduite.
Pour autant, nous sommes confiants pour l’avenir et réitérons nos conseils d’investir sur l’Europe, sur l’IA (et de fait sur les grandes capi US) sur les belles sociétés qui versent tous les ans un dividende supérieur à celui de l’année précédente et sur la classe d’actif des produits structurés pour aller chercher du rendement en diminuant le risque.
N’oublions pas qu’une allocation « Action » est un investissement à horizon 5 ans et qu’il y a actuellement des opportunités.
Ecrit par Patrick Gautier, Directeur Gestion Privée Paris